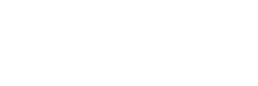Résistantes 2025
Intro : Qu’est-ce que l’écofascisme? Essai de clarification conceptuelle
Sous-groupe n.1 : Vers une écologisation du fascisme ?
Résumé synthétique : L’écologie politique, longtemps associée à la gauche, fait désormais l’objet d’une récupération par certaines droites radicales, qui en proposent une lecture identitaire, hiérarchisante et autoritaire. Cette écologisation du fascisme s’appuie sur des corpus idéologiques anciens, comme ceux de la Nouvelle Droite, articulant défense des écosystèmes et rejet de l’universalisme. Ce tournant écofasciste prend plusieurs formes : une écologie enracinée liant culture et territoire, un écodifférentialisme qui naturalise les frontières culturelles et ethniques, voire une écologie eugéniste et hiérarchique prônée par Rochedy. À rebours d’un cosmopolitisme écologique, ces discours valorisent l’homogénéité, la fermeture, le localisme défensif, et posent les migrations comme menaces écologiques. Pour contrer ces dérives, des voix appellent à une écologie antifasciste, plurielle, inclusive, déconstruisant les usages réactionnaires des notions de nature, de communauté ou d’ordre.
Sous-groupe n.2 : Écologie réactionnaire et fascisation de l’écologie
Résumé synthétique : Aux États-Unis, l’écofascisme s’appuie sur l’association entre nature et identité nationale, justifiant l’exclusion des minorités au nom de la « pureté » du territoire (ex : Edward Abbey, Tucker Carlson). En France, des groupes comme Anti-Tech Resistance (ATR) défendent un écologisme radical anti-technologie qui rejette les luttes progressistes (féminisme, antiracisme, LGBTQIA+, etc.), au nom d’une efficacité stratégique et d’une vision essentialiste de la Nature. Ce rejet du pluralisme ouvre la voie à une écologie autoritaire, voire fascisante. Toutefois, certains auteurs (comme Pierre Madelin) préfèrent parler de confusionnisme plutôt que d’écofascisme, estimant que le terme est parfois utilisé à outrance.
Sous-groupe n.3 : Comment les industries fossiles voient l’extrême-droite et le fascisme
Résumé synthétique : Il semble que les multinationales préfèrent travailler avec des régimes autoritaires (mais non nécessairement fascistes) comme en Birmanie ou en Tanzanie. Cependant elles s’adaptent extrêmement bien aux régimes libéraux, en corrompant l’Etat à différents échelons (cf la récupération de Bernard Kouchner) et utilisant l’ouverture des différents marchés nationaux offerts par le libéralisme. Elles se méfient même des états nationaux et des nationalistes en temps normal car ceux-ci peuvent s’opposer à leurs stratégies internationalistes et restaurer des barrières douanières. Les multinationales peuvent également se passer d’Etat et favoriser les deux côtés d’un conflit pour récupérer des parts, elles sont dans certains cas plus puissantes que des Etats (cf nationalismes et guerre). Cependant en cas de crise, comme la crise écologique, la classe capitaliste peut faire le choix des fascistes comme stratégie du moindre mal pour maintenir le business as usual.